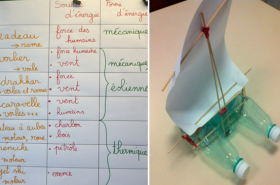Objectifs visés :
- Envisager le potentiel interdisciplinaire et interdegrés du défi.
- Envisager la programmation du défi au cours d'une année scolaire.
- Lier le défi aux connaissances scientifiques qu'il permet d'aborder.
- S'approprier des outils de planification pour rendre le défi plus efficace vis-à-vis des apprentissages et du parcours des élèves.
- Mettre en œuvre le défi avec ses élèves.
- Partager son expérience avec d'autres professeurs.
Déroulement du tutoriel :
- Vivre une mise en situation.
- S'approprier des outils pour utiliser une vidéo de scientifique lors du lancement d'un défi aux élèves.
- Consulter des ressources clés en main.
- Réinvestir les outils acquis lors de ce tutoriel avec ses élèves, en classe, et échanger avec d'autres professeurs.
Informations complémentaires : Si vous cherchez d'autres modalités pour lancer un défi à vos élèves avec l'aide d'un(e) scientifique, n'hésitez pas à consulter les tutoriels faisant partie de la même collection.
ACCÉDER AU TUTORIEL D'AUTOFORMATION "Défi "A l'abordage !"" SUR LA PLATEFORME D'ELEARNING L@MAP
Rejoignez l'aventure À l'abordage !
Embarquez vos élèves dans l'aventure À l'abordage , pour l'année scolaire 2025-26 !
Inscrivez-vous via ADAGE en renseignant "À l'abordage", et rejoignez ainsi la communauté pour bénéficier d'un accompagnement :
- Des tutoriels, des ressources pédagogiques adaptées à chaque cycle ;
- Un accompagnement en ligne tout au long de l'année par des formateurs scientifiques ;
- Trois visioconférences, dont une avec es élèves pour clôturer le projet (en octobre 2025, en février 2026, en juin 2026) ;
- Des vidéos sur les métiers de l'ingénierie à partager avec votre classe.