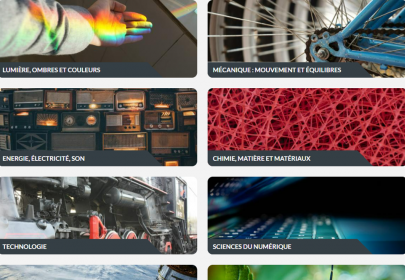Une expérience première
Voici une perception des plus primitives : j’ouvre les yeux, et je vois des couleurs. Le monde est coloré. Ce qu’il est beau ! Luxuriance des couleurs d’ailes de papillons, des fleurs, des gemmes, des poissons dans une mer tropicale. Féerie des couleurs d’un feu d’artifice, chatoiement de la lumière à l’intérieur de la Sainte-Chapelle ou de la cathédrale de Chartres, richesse des couleurs des joyaux où jouent les réflexions de la lumière, paillettes étincelantes que les symétries multiplient dans un kaléidoscope… On retrouve aisément cet enthousiasme naïf pour la couleur, il suffit, par exemple, de relire les commentaires des contemporains, nos grands-parents, lorsque le cinéma s’est « technicolorisé ».
Néanmoins, toutes ces couleurs naturelles posent les questions du comment, voire du pourquoi. N’est-il pas légitime de vouloir savoir ce qui fait le rougeoiement d’un lever ou d’un coucher de soleil ?
Que la réponse implique une interaction entre la lumière du soleil et des particules solides dans l’atmosphère – et que donc la pollution atmosphérique nous gratifie de superbes couchers de soleil – n’était pas évident a priori, et convainc, s’il le fallait, que la science doit se préoccuper de la couleur.
Parmi les nombreuses questions pertinentes que l’on peut se poser sur la couleur, j’ai choisi de privilégier dans cette présentation celles ayant trait, d’une part aux colorants, d’autre part aux pigments, surtout pour l’utilisation qui en est faite par les artistes.
Quelques clarifications
La perception de couleur d’un objet est liée à notre œil, mais nous savons aussi qu’elle dépend du corps qu’il regarde, et enfin de la lumière qui éclaire l’objet : les ombres au sol dans un tableau de van Gogh sont bleues et non noires, simplement parce que le sol, à l’ombre du soleil, reste éclairé par le ciel bleu : il y a donc au moins trois facteurs dans la perception de la couleur. Le premier est la composition spectrale de la lumière qui éclaire, c’est-à-dire les proportions relatives des différentes longueurs d’onde qu’elle contient. Le deuxième est la nature du corps qui reçoit cette lumière et va la renvoyer vers l’œil (ce qu’on appelle la diffusion de la lumière) : nous distinguerons dans ce qui suit les pigments (particules colorées et solides, donc insolubles) et les colorants (corps en solution, donc liquides). Le troisième est la façon dont l’œil – tous les yeux ne sont pas identiques quant à la perception colorée, et on sait aussi que l’œil s’éduque – traduit cette lumière reçue en perception. C’est cette multiplicité de facteurs qui fait la richesse de la notion de couleur, et ses infinies déclinaisons où se mêlent l’objectivité de l’éclairement et la subjectivité de la perception.
La vision des couleurs
Il neige d’abondance au moment où j’écris ce paragraphe. Le paysage semble être devenu une carte postale en noir et blanc. Certes, les champs de neige, les toits enneigés, ainsi que la diffusion de la lumière par les flocons tombants contribuent tous ensemble à une surabondance du blanc, qui masque aussi des couleurs, telles que le vert sombre de proches forêts de conifères. Et d’ailleurs le dicton ne dit-il pas « La nuit, tous les chats sont gris » ? De telles perceptions nous rappellent que la rétine possède des cellules appelées récepteurs, pour la vision nocturne (les bâtonnets), sensibles à la seule intensité lumineuse ; tandis que la vision diurne fait intervenir d’autres cellules, les cônes, dont trois types coexistent chez la plupart d’entre nous (les daltoniens sont l’une des exceptions). C’est le génial britannique Thomas Young (1773-1829) qui fit cette découverte.
Les trois variétés de cônes diffèrent par la longueur d’onde à laquelle ils absorbent préférentiellement la lumière qui les frappe. Nous savons à présent que cette diversité renvoie à de menues différences structurales dans la disposition d’un constituant rétinien (le rétinal) sur la protéine qui le fixe (l’opsine). En résumé, si le constituant rétinien est sensible à la longueur d’onde de la lumière, il y a sensation ; sinon nous sommes aveugles, par exemple aux longueurs d’onde de l’infrarouge ou de l’ultraviolet (qui peuvent en revanche détruire des cellules).
Je borne à cette seule indication le repérage de la chimie de la vision : c’est un domaine scientifique, déjà bien exploré ; nous savons ainsi qu’entre l’absorption de lumière par les récepteurs rétiniens et l’impression lumineuse résultante enregistrée par le cerveau interviennent des dizaines – je dis bien, des dizaines – d’étapes élémentaires de réactions chimiques diverses, à présent élucidées – c’est le cas de le dire – dans leur foisonnant détail.
Larcin de couleurs
Parmi les multiples définitions qu’on peut offrir de l’homme et de l’humain, je propose celle-ci : l’homme est un voleur de couleurs, il prend à la nature ses couleurs pour se les approprier.
Faut-il des exemples ? Au Moyen Âge, les enluminures des manuscrits avaient des couleurs prélevées dans la nature. Les bleus les plus riches, les plus honorifiques aussi, ceux dont la robe du saint patron de l’abbaye était peinte, étaient au nombre des pigments les plus rares : ils provenaient du lapis-lazuli broyé en poudre, puis suspendu dans une huile avant d’être appliqué. De nombreux siècles durant et dans toute l’Europe et l’Asie, ce minéral provenait d’une mine unique, située en Afghanistan !
L’encre de la seiche a servi à faire des encres et des colorants, de teinte sépia (du nom de la seiche en latin). La pourpre impériale, dont la toge des empereurs romains était teinte, et qui possédait donc la valeur sacralisée d’un attribut du pouvoir, provenait d’un coquillage de la Méditerranée du genre Murex. Parmi les colorants aux tonalités rouges et utilisés de longue date, on trouve aussi le carmin, provenant d’insectes tels que kermès européens ou cochenilles d’Amérique centrale. Ces colorants eurent des utilisations variées, ils servirent aussi bien pour la coloration des aliments que dans la fabrication des cosmétiques.
Le sang est de l’eau colorée en rouge par l’hémoglobine dissoute ; et l’homme l’a utilisé comme colorant : longtemps, les fermiers américains usèrent de sang de bœuf pour repeindre, une fois l’an, l’extérieur de leurs granges ; et c’est resté l’une de leurs couleurs traditionnelles.
Toujours au nombre des couleurs rouges prélevées dans la nature, la garance fut cultivée dans le Midi durant des siècles pour le colorant qu’elle fournissait. La synthèse de l’alizarine par Carl Graebe (1841-1927) et Karl Liebermann (1842-1914) et la production industrielle subséquente de ce colorant mirent un terme à cette activité (et ce n’est qu’après quelques mois de carnage en 1914 que l’état-major français renonça à cette couleur pour les pantalons des fantassins français, qui en faisaient de superbes cibles).
D’autres plantes cultivées, elles aussi dans le Midi, pour les colorants bleus qu’on en tirait furent le pastel (Isatis tinctoria) et l’indigo (genre Indigofera, une papilionacée). La teinte de l’indigo (également de synthèse à présent) est celle qu’on voit sur les blue jeans, faits de coton teint par de l’indigo, un tissu originaire de Nîmes (la langue américaine en tira le mot denim).
Parler des vives couleurs dont se parent les fleurs est un lieu commun. Plus généralement, la pensée lie les êtres vivants à leurs couleurs ; et le lexique en conserve trace, dans des dénominations de couleurs telles que : citrine, orange, abricot, rose, lilas, safran, jonquille, ébène, ivoire, gorge-de-pigeon, noir corbeau, corail, chair, incarnat, vert pomme, bordeaux (par référence à la robe de ses vins ; ou de même, en anglais, burgundy red, « rouge Bourgogne »), cerise, prune, violet, aubergine, épinard, crème…
Colorants et indicateurs colorés
Nous pouvons donc définir un colorant, tout au moins dans l’archéologie du savoir à laquelle nous cédons ici, comme une couleur empruntée à la nature, et que nous utilisons par exemple pour teindre un tissu.
La teinture est donc une fixation des molécules du colorant sur celles de l’objet à teindre, avec peu d’altération de la couleur. En règle générale, un liquide coloré (autrement dit une solution liquide du colorant dans un solvant) sert de moyen terme : on extrait la couleur d’un organisme au moyen d’un solvant ; et l’on plonge une étoffe, par exemple, dans ce solvant afin qu’elle en prenne la couleur. De telles techniques, extrêmement anciennes, ont pu prendre naissance dans la constatation que font les enfants lorsqu’ils jouent avec leurs doigts maculés de jus de mûres ou de brou de noix.
Ce dernier exemple est plein d’intérêt, puisque la substance naturelle, dans l’écorce verte autour de la coque de la noix, est incolore ; elle ne brunit qu’au contact de l’air, par oxydation (c’est-à-dire par la combinaison avec l’oxygène atmosphérique). On pourrait donc dire de cette substance naturelle (et d’autres du même type) qu’elle est un indicateur de la présence d’oxygène.
La « solution bleue »
Cette expérience, qui manipule des produits caustiques, n’est pas à faire avec des élèves. En revanche, elle peut être préparée par le maître, et les élèves peuvent observer et discuter les résultats. Il s’agit d’une solution aqueuse, assez fortement basique (aptitude des molécules à fixer les atomes d’hydrogène privés de leur électron – protons –, soit H+), obtenue par dissolution de soude ou de potasse (attention ! ces produits peuvent être dangereux à manipuler), contenant un sucre réducteur (hostile à l’oxygène) comme le glucose. Cette solution incorpore aussi du bleu de méthylène. Au repos dans un flacon, surmontée d’une certaine quantité d’air, cette solution reste limpide et incolore. Vient-on à l’agiter vigoureusement, elle se colore d’un beau bleu, qui s’évanouit au bout de quelques instants. Ce dispositif est propice à un apprentissage de l’observation, et à celui d’un début d’expérimentation : on peut se convaincre aisément que l’apparition de la couleur bleue dépend de la présence d’une atmosphère gazeuse au-dessus de la solution ; qu’il faut qu’elle contienne de l’oxygène (on peut faire la contre-épreuve avec du butane) ; que l’intensité de la coloration dépend du volume de cette atmosphère surmontante ; que la durée de la coloration est fonction de la durée de l’agitation ; etc.
Bref, on peut ainsi découvrir graduellement que le bleu indique l’oxydation d’une substance présente dans la solution. En termes techniques, le bleu de méthylène existe sous deux formes, une forme réduite (privée d’oxygène) qui est incolore, et une forme oxydée, de couleur bleue, comme son nom l’indique. Ainsi, le système manipulé oscille-t-il entre la forme réduite, dont nous sommes redevables à la présence du sucre dissous dans la solution ; et la forme oxydée, bleue, dont nous sommes redevables à la présence d’oxygène dans la solution, à chacune des agitations mécaniques, mettant en contact le liquide et l’oxygène de l’air.
On montre tout aussi aisément que des colorants, y compris des substances naturelles, peuvent être utilisés pour définir le caractère acide (aptitude des molécules à expulser des protons H+) ou basique d’une solution aqueuse. Pour cela, il est possible d’emprunter à des plantes leurs colorants. C’est ainsi qu’on peut extraire par de l’eau chaude la couleur du chou rouge, découpé au préalable en petites lamelles. On obtient de la sorte, après refroidissement et filtration, un jus de chou rouge.
On constate qu’il est utilisable pour teindre de petits bouts de papier ou de coton. Placez dans un tube à essai quelques gouttes de cette solution colorée : si on la dilue avec de l’eau, la coloration s’estompe comme on s’y attend. Cette coloration est proportionnelle à la concentration du colorant.
Placez dans un autre tube à essai quelques gouttes du même jus de chou rouge, diluez-le un peu. Si vous introduisez à présent un peu d’une substance acide, comme le vinaigre ou le jus de citron, la coloration change ; elle vire d’un pourpre à un rouge. Si vous introduisez par contre, dans une solution aqueuse similaire, un peu d’une substance basique, comme du détergent pour lave-vaisselle, la coloration change aussi : elle vire d’un pourpre vers un bleu.
En d’autres termes, notre extrait aqueux de chou rouge est un « indicateur coloré », dont la couleur est diagnostique du caractère acide ou basique d’autres solutions aqueuses. Il existe ainsi un grand nombre de substances, naturelles (pigments anthocyanes de fleurs comme les hortensias) ou de synthèse (phtaléine du phénol, par exemple), sensibles à l’acidité du milieu. Le « papier pH », dont la coloration permet d’évaluer approximativement le caractère acide ou basique d’une solution aqueuse, met à profit cette propriété de nombreuses molécules colorées, dont la couleur dépend de l’éventuelle addition (ou soustraction) d’un proton H+.
Certains colorants naturels sont des mélanges
Il convient de se garder d’identifier la science à un ensemble de connaissances bien établies, où on irait chercher la réponse à une question comme on tend la main vers un livre dans la bibliothèque, ou vers un pot de confitures sur une étagère. Sa dimension critique lui est essentielle. La science, c’est surtout un questionnement, ainsi qu’une mise en doute permanente des savoirs paraissant acquis.
Il nous faut aller ici contre l’idée simpliste « une couleur égale une substance responsable de cette couleur ». On peut se convaincre aisément qu’en règle générale toute couleur de la nature est due au mélange de plusieurs substances.
Pour ce faire, il suffit de préparer un « jus d’épinard », analogue au jus de chou rouge précédent. L’acétone – commercialisée comme « dissolvant » pour ôter les vernis à ongles – permet d’extraire la couleur verte des feuilles d’épinard, préalablement dilacérées et broyées dans un mortier. On obtient ainsi, comme précédemment, après filtration, un jus d’épinard bien vert.
On peut procéder alors à une chromatographie : on prend une bandelette (environ 4 cm sur 12 cm) de papier-filtre (filtres à café). On trace un trait au crayon parallèle au bord, à 1 cm de celui-ci. À l’aide d’une pipette Pasteur (ou d’un compte-gouttes), on dépose quatre ou cinq fois de suite au même endroit, au milieu du trait, une goutte de jus d’épinard. On prend bien soin de laisser sécher entre chaque application. Puis on met au fond d’un récipient cylindrique en verre (pour lequel on aura prévu un bouchon) un peu (0,5 cm de hauteur) d’un solvant d’élution, qui pourra être à base de white-spirit. On place la bandelette verticale, appliquée contre le bord interne du verre et trempant sa base dans le liquide, et on rebouche. Le solvant humecte le bas du papier et commence son ascension par capillarité, entraînant avec lui les molécules colorées : une demi-heure ou une heure plus tard, on pourra constater la séparation des divers colorants qui étaient présents dans les feuilles d’épinard, et où coexistent des colorants jaunes (carotènes, xantophylles) et des colorants verts (chlorophylles).
Cette expérience de chromatographie peut aussi être faite par les enfants à partir des colorants contenus dans les crayons-feutres (séparation du bleu et du jaune d’un crayon vert).
Cette même coexistence fait la beauté des feuillages d’automne : lorsqu’il commence à faire froid, les arbres ne synthétisent plus de chlorophylle verte, et les feuilles prennent la couleur des autres colorants et pigments présents : des jaunes, des ocres, des rouges et des teintes de vieil or. Il en va ainsi de la couleur des pétales de fleurs : celle-ci provient d’auto-assemblages moléculaires très complexes.
Cela souligne à nouveau combien la couleur résulte de l’effet sélectif, sur la lumière incidente, de liaisons chimiques spécifiques au corps éclairé : que ces liaisons soient modifiées par l’adjonction d’un atome ou la présence d’une autre liaison proche, et l’effet sur la lumière que va transmettre ou diffuser la molécule peut changer, conduisant à une autre composition spectrale de cette lumière.
Couleurs dans une flamme
La fusée du feu d’artifice jaillit en un souffle qui devient sifflement. A son apogée, elle expire et projette son contenu, une poussière de paillettes lumineuses qui retombent lentement, achevant de se consumer. « Oh, qu’elle est belle ! » auront pu s’écrier certains des spectateurs de la fête, égayée par cette pyrotechnie (c’est le nom donné à la présentation publique de quelques-unes des couleurs de la chimie). Lorsque la fusée a explosé, les atomes des composés chimiques présents dans la poudre ont été portés à plusieurs milliers de degrés, et ils ont irradié toutes ces couleurs, pour le plaisir de l’œil.
Pour vous en faire une idée visuelle, il vous suffit de projeter une pincée de sel dans une flamme chaude, celle de l’âtre ou d’une cuisinière à gaz : vous verrez alors la belle coloration jaune, caractéristique des atomes de sodium. Dans les atomes portés à haute température, les électrons sont hissés vers des états d’énergie élevée d’où ils retombent spontanément vers des étages inférieurs, en émettant une lumière dont la longueur d’onde est une signature de cet élément : si, au lieu d’un dérivé du sodium comme le chlorure de sodium, vous aviez projeté un sel de cuivre, la flamme serait devenue d’un beau vert ; si cela avait été du strontium, elle aurait acquis une somptueuse teinte rouge.
Ce n’est pas autrement que font les astronomes pour établir la composition chimique d’une étoile. À sa couleur – à ses couleurs, pour être plus précis, après avoir décomposé, au moyen d’un spectrographe, la lumière captée par le télescope en ses longueurs d’onde qui y coexistent –, ils savent ce qu’elle contient.
Chimistes et couleurs
Si l’homme vole ses couleurs à la nature sous forme dissoute de colorants, il les prélève aussi sous forme de pigments : un pigment, par définition, est fait de particules colorées insolubles. Il est licite de parler de science et de technique à propos de l’utilisation artistique, de très, très longue date, de pigments.
Dans les paragraphes qui suivent, la formule chimique indique la composition élémentaire du corps : cette composition se retrouve depuis l’échelle microscopique jusqu’à celle, macroscopique, du pigment. On y reconnaît des atomes (Cu = cuivre, O = oxygène, As = arsenic, etc.) dont les proportions relatives sont indiquées par des coefficients (2, 3...).
Les peintures pariétales utilisent des pigments, suspendus dans une huile ou une graisse pour leur application, tels que l’oxyde de manganèse MnO2 ou du noir de carbone pour les noirs, des oxydes de fer de diverses compositions formant l’ocre pour les rouges, une barbotine de kaolin ou d’autres minéraux pour les blancs, etc. Ces pigments solides résistent admirablement au temps : les peintures de la grotte Chauvet, dans l’Ardèche, sont datées de – 30 000 ans ; la frise des chevaux de Pech-Merle de – 24 000 ans !
D’autres utilisations artisanales ou artistiques de la couleur sont elles aussi très anciennes : les premiers émaux de poterie remontent à – 4 000 ans, la teinture et le mordançage préalable des textiles datent de – 2 000 ans, et la première utilisation de colorants organiques date de 1 200 ans avant notre ère.
Nous sommes redevables aux alchimistes de la découverte et de l’utilisation de nombreux pigments. Citons : le cinabre ou vermillon, qui est un sulfure mercurique – l’alchimiste chinois Ko Hong (283-343) le considérait comme la panacée ; le minium, ou rouge de plomb, de composition Pb3O4 ; la litharge, qui est un jaune-rouge de plomb PbO ; l’orpiment, minerai d’arsenic de composition AsS3 ; les divers vitriols (bleu, vert…) qui sont autant de sulfates cuivrique, ferreux, etc.
Le plus ancien pigment utilisé par l’homme, selon certains, serait le blanc de plomb, c’est-à-dire un carbonate basique de ce métal. En mélange avec le sulfate de baryum, un autre pigment blanc, il constitue ce qu’on nomme le « blanc vénitien ».
Ce n’est qu’après le déclin de l’alchimie, ravalée au rang d’un savoir occulte et d’une pseudo-science à l’époque de Lavoisier et du triomphe de la chimie rationnelle, qu’elle contribua si fortement à asseoir, que les chimistes prirent le relais, et que l’on assista aux débuts de l’étude scientifique des couleurs et des pigments. Les chimistes français tinrent leur partie dans cet effort collectif.
On doit ainsi au baron Thénard (1777-1857) (que Victor Hugo tenait en piètre estime, ce qui lui fit nommer « Thénardier » l’horrible famille dans Les Misérables !) l’invention du bleu de cobalt. Jean-Baptiste Dumas (1800-1884) fut l’auteur d’un Traité de chimie appliquée aux arts (1828) (il faut ici entendre « artisanats »).
Jean Chaptal (1756-1832) fut, quant à lui, très conscient de l’opposition entre la tradition artisanale de divers savoir-faire ou coups de main, que l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert avait justement prônés, et l’innovation scientifique, venue les bousculer, sinon les écarter : « Connoissez mieux vos matières premières, pourroit-on dire aux artisans ; étudiez mieux les principes de votre art, et vous pourrez tout prévoir, tout prédire et tout calculer : c’est votre seule ignorance qui fait de vos opérations un tâtonnement continuel et une décourageante alternative de succès et de revers. »
Mais la palme revient incontestablement à Michel Eugène Chevreul (1786-1889). Il fit toute sa carrière au Muséum d’histoire naturelle, mais fut aussi nommé en 1824 directeur des ateliers de teinture à la Manufacture des Gobelins. Aussi fut-il amené à s’intéresser de près à la teinture, ainsi qu’à la perception des couleurs. Après un article de 1828 sur le sujet, il publia en 1839 De la loi du contraste simultané des couleurs, où il signalait que l’œil, lorsqu’on regarde fixement un secteur coloré, voit au bout d’une vingtaine de secondes apparaître une couleur complémentaire. La juxtaposition de deux secteurs colorés affecte donc chacun d’une perturbation par la couleur complémentaire de l’autre.
Cette observation, dont prit connaissance le grand public lors de la publication, en 1886, par l’Imprimerie nationale, des Œuvres complètes de Chevreul pour son centenaire, ne laissa pas d’intéresser vivement certains peintres, qu’elle influença durablement, Georges Seurat tout particulièrement. Un tableau comme La Grande Jatte est une exploitation pointilliste de la théorie de Chevreul. Plus tard, Robert Delaunay sera lui aussi influencé, dans le chromatisme divisionniste (pointilliste) de ses premiers tableaux, par la théorisation du chimiste.
Dix pigments
Le vert Véronèse (ou vert émeraude) est un acétoarsénite de cuivre de composition Cu (AcO)2, 3Cu (AsO2)2. Il fut inventé par Russ et Sattler à Schweinfurt en 1814, à partir d’arsenic et de vert de gris. Justus von Liebig (1803-1873) et le Français Henri Braconnot (1780-1854) introduisirent des procédés de fabrication industrielle dès 1822. Sous le nom de « vert de Paris », ce fut le premier insecticide chimique, vendu pour cette utilisation à partir de 1867 environ. D’ailleurs, la toxicité de ce pigment le fit retirer de la production et de la vente aux artistes dans les années 1960.
Paul Cézanne l’a utilisé, pour des aquarelles en particulier : hélas, comme on peut le constater sur la série conservée au musée de Philadelphie, ce pigment brunit sous l’effet des sulfures atmosphériques (Cézanne ne reconnaîtrait plus ses œuvres aujourd’hui…).
[De telles déprédations causées par le vieillissement posent la question de la valeur de l’œuvre d’art : il importe de distinguer, aussi bien en principe qu’en pratique (l’état de la technique le permet à présent), la valeur patrimoniale – celle du commerce de l’art –, et la valeur esthétique – celle de l’œuvre, telle que le génie de Cézanne l’a conçue. La reproduction, par les moyens sophistiqués dont nous disposons, doit être conforme à la seconde définition, bien entendu.]
Le vert émeraude, de composition Cr2O3, 2H2O, fut conçu par Pannetier, à Paris, en 1813. Guignet brevettera un procédé pour l’obtenir en 1859. Claude Monet, sans doute du fait de son extrême dénuement, dut l’abandonner dans les années 1870. En effet, à la fin du XIXe siècle, ce pigment était deux fois plus cher que le vert Véronèse.
De la naissance du Christ jusqu’à Waterloo, l’homme utilisa comme seul pigment bleu outremer des broyats de lapis-lazuli, un minéral lui aussi onéreux puisque exotique. On lui trouvait bien, lorsque son prix le rendait prohibitif, des succédanés fournissant l’impression picturale d’un bleu, par exemple en superposant des couches de peintures blanche et noire. Aussi, lorsque J. -B. Guimet trouva, en 1828, un pigment d’un bleu proche, qu’il nomma donc outremer, son invention fut acclamée ; le gouvernement français lui décerna un prix (créé pour inciter à cette fabrication). Il s’agit d’un silicate mixte d’aluminium et de sodium, de composition Na6-10 Al6 Si6 O24 S2-4. On trouve cet outremer dans certains bleus de la toile d’Auguste Renoir qui a pour titre La Première Sortie (1875-1876).
Le bleu de cobalt, de composition CoO. Al2O3, fut donc inventé, comme nous l’avons déjà vu, par Thénard en 1808. Il servit à Claude Monet pour rendre le bleu de l’eau de la Seine dans son œuvre bien connue : La Grenouillère (de 1869), que l’on peut voir au Metropolitan Museum à New York, (« La Grenouillère » était un restaurant, situé à côté d’une baignade très populaire, proche de Chatou, sur la ligne de chemin de fer de Paris à Saint-Germain en Laye).
Le bleu de Prusse, de composition Fe3+ (NH4) Fe2+ (CN)6, découvert au tout début du xviiie siècle, dénommé parfois « vert de Berlin », était un pigment bon marché. Alors que Claude Monet l’abandonnait dans les années 1870, il avait abondamment servi à l’ami de Baudelaire, Constantin Guys (1802-1892) pour ses « reportages » dans les magazines populaires de l’époque, comme The Illustrated London News, sur les événements contemporains, par exemple, en août 1852, pour le cortège funèbre du maréchal Exelmans.
Le jaune de chrome, de composition PbCrO4, est un pigment dont nous sommes redevables aux alchimistes. Introduit en 1800, il servait, combiné à du bleu de Prusse, à obtenir des verts. La composition de Monet, La Grenouillère, dont il a déjà été question, en montre l’utilisation. Néanmoins, les impressionnistes délaissèrent ce pigment vers la fin des années 1870. L’un de ses défauts est de s’assombrir en présence de sulfures. Or, il faut savoir que l’atmosphère en contient souvent des traces, dues à l’activité industrielle.
Le jaune de chrome fut remplacé, dans une certaine mesure, par le jaune de cadmium, de composition CdS. Ce pigment date lui aussi de la première partie du XIXe siècle (1825). Monet y eut constamment recours de 1840 à 1860. Mais l’inconvénient majeur de ce pigment est sa grande toxicité, ce qui l’a fait abandonner ces dernières années par les fabricants et marchands de couleurs. Aux États-Unis, ses ventes ont décliné de soixante-quinze pour cent durant la période 1987-1995.
Il existe divers pigments rouges répondant au même nom de « vermillon ». Le principal est le sulfure mercurique HgS, mais on a aussi un vermillon d’antimoine, de composition élémentaire Sb2S3, ainsi que des vermillons organiques (celui de la maison Sennelier, entre autres). Toujours dans cette même toile de Monet, La Grenouillère, le vermillon a servi à peindre les fleurs rouges qu’on aperçoit dans la partie gauche. Pour citer un autre chef-d’œuvre, Georges de La Tour usa de vermillon dans La Diseuse de bonne aventure pour faire un effet d’optique sur la manche du dupé, ainsi qu’un halo autour de sa ceinture rouge.
Disons enfin un mot des pigments blancs : il a déjà été question du blanc de plomb, le carbonate PbCO3 déjà connu dans l’Antiquité des Égyptiens, des Grecs et des Romains. La signature isotopique de l’élément plomb permet d’établir sa provenance avec précision, ce qui est utile pour authentifier une œuvre, et localiser l’origine des pigments (il existe différents types d’atomes de l’élément plomb, comme de la plupart des autres. Ces atomes de plomb ont tous les mêmes propriétés chimiques, mais des masses différentes : on les appelle isotopes du plomb). Ce blanc a l’avantage d’être lipophile, s’accommodant donc bien de la peinture et de l’huile, et plastique. Monet l’a surtout utilisé dans ses œuvres tardives.
Le blanc de titane est le pigment blanc du XXe siècle : de composition TiO2, il existe sous les deux formes cristallines que sont l’anatase et le rutile. L’anatase fut le premier à être utilisé en peinture : préparé en 1914 par Barton et Rossi, il fut commercialisé chez Bourgeois en 1925 et chez Lefranc en 1927. Le rutile apparaît sur le marché américain en 1941. Sa fabrication par la firme DuPont de Nemours à partir du tétrachlorure de titane TiCl4 date de 1950 ; et le rutile arrive en Europe en 1956. Nous l’avons tous utilisé, sous forme d’une suspension dans un solvant volatile, le liquid paper ou correcteur de fautes d’écriture. Et vous aurez constaté l’opacité de ce pigment, qui en permet d’autres utilisations, le couchage du papier d’écriture en particulier.
L’œuvre d’art au risque du laboratoire
La détection spectroscopique de divers pigments est donc très utile pour l’information qu’elle donne sur un artiste et sur une œuvre.
C’est ainsi – pour donner suite à ce qui précède au sujet du blanc de titane – qu’on le trouve dans Le Rocking-chair que Picasso peignit en 1943, associé à du sulfate de baryum, autre pigment blanc : il semblerait que le peintre ait voulu expérimenter et créer son propre équivalent moderne au blanc vénitien.
L’intervention du laboratoire, dans l’étude scientifique des peintures, montre la prudence avec laquelle on doit avancer des assertions : qui ne concluerait volontiers de la présence de fer dans une peinture bleue qu’il s’agit de bleu de Prusse ? Or, il faut savoir que le spectre de fluorescence X (la fluorescence désigne la lumière émise par la toile lorsqu’elle est éclairée par une lumière formée de rayons X) est compatible avec une couche d’outremer superposée à une préparation de la toile à base d’une terre contenant du fer.
Toujours à ce sujet, rappelons la monumentale controverse autour de La Diseuse de bonne aventure, tableau dont nous avons déjà parlé.
Elle démarra lorsque fut dénoncée la bizarrerie des costumes et qu’il fut établi que le châle avait été copié d’un tapis apparaissant dans une Vierge à l’Enfant de Joos van Cleeve. Plus troublant encore, on voit distinctement à l’aide d’une loupe le mot « merde » inscrit sur le col d’une jeune gitane. À l’appui de l’authenticité, l’analyse chimique vint par contre apporter une confirmation : le peintre – qu’il soit ou non Georges de La Tour – a bien utilisé des pigments jaunes, dont la composition fait intervenir étain (Sn) et plomb (Pb), caractéristiques du XVIIe siècle.
Conclusion
Je me suis limité à quelques points, préférant leur approfondissement à une illusoire exhaustivité. Les thèmes non abordés sont bien plus nombreux que ceux traités. Je n’ai rien dit des phénomènes physiques colorés que sont, pêle-mêle, la décomposition de la lumière blanche par un prisme, le bleu du ciel ou l’irisation d’une bulle de savon. Je n’ai abordé ni la photographie, ni la photocopie ou l’impression en couleurs, ni encore l’écran de télévision en couleurs – bien qu’il s’agisse d’objets de la vie courante, familiers à tous, qui, chacun, forment aussi d’astucieuses applications de la science chimique à des visualisations polychromes.
Mais il y a plus grave que l’omission de nombreux savoirs pertinents. C’est lorsque l’exposé, à force de vouloir simplifier, supprime ces continuités et ces contiguïtés essentielles à la science dans son questionnement. J’en veux pour exemple ces jus colorés, résultats de l’usage d’un solvant pour extraire sa couleur à un objet de la nature, tel qu’une plante. J’ai laissé croire que la couleur de chacune de ces solutions liquides est identique à celle de la substance naturelle, ce qui n’est, ce qui ne peut être le cas que de manière approximative pour au moins deux raisons : la couleur d’une solution dépend de la nature du solvant (le fait même qu’il y ait dissolution indique la présence nécessaire d’interactions entre les molécules du colorant et celles du solvant) ; les molécules du colorant sont associées dans l’objet naturel, un système complexe, à d’autres atomes et molécules qui, de même, les perturbent.
Si j’ai mis l’accent sur l’interaction de l’art et de la science, et sur leurs apports mutuels si impressionnants – l’expression « en voir de toutes les couleurs » peut être prise au pied de la lettre –, c’est surtout parce que l’un et l’autre sont l’honneur de l’homme et qu’ils nous offrent des raisons d’espérer (et donc de continuer à lutter) dans notre vallée de larmes et dans notre village dominé par l’injustice ainsi que par des valeurs faussées, par ces tares que sont le médiocre et le mesquin. L’expression « en voir de toutes les couleurs » est souvent utilisée dans son sens le plus tristement ordinaire…
Et pour aller plus loin, quelques questions d’enseignants
Pourquoi et quand dit-on qu’une couleur est saturée ?
Une couleur pure est une lumière strictement limitée à une seule longueur d’onde (ou à un intervalle de longueur d’onde très petit) : elle est alors dite saturée. Si à cette couleur est progressivement ajouté du blanc, la couleur apparaît de plus en plus « lavée » : on dit que sa saturation diminue. Sur un téléviseur, il existe un réglage de la saturation des couleurs.
Comment peut-on réaliser une synthèse additive ou une synthèse soustractive de la lumière ?
Il s’agit en fait de la synthèse additive ou soustractive des couleurs.
Comme l’anglais Thomas Young le montra à la fin du XVIIIe siècle, l’œil possède des récepteurs sensibles à trois couleurs différentes. Ces trois couleurs sont dites primaires : en effet, par combinaison linéaire (c’est-à-dire en variant leur proportion dans une lumière formée par addition de ces longueurs d’onde), on peut obtenir la perception d’une couleur quelconque (c'est la synthèse additive). La même perception peut également être obtenue en partant d’une lumière blanche de laquelle on a soustrait une des couleurs primaires (c'est la synthèse soustractive). La télévision en couleurs fonctionne sur le principe de la synthèse additive, tandis que les couleurs des images imprimées fonctionnent par synthèse soustractive (la page est éclairée en lumière blanche, à laquelle les encres enlèvent certaines couleurs).
Qu’est-ce que le disque de Newton ?
Un disque peint de trois secteurs égaux colorés de couleur primaire (rouge, vert, bleu) est mis en rotation rapide. La perception visuelle ayant un temps de persistance de l’ordre de 0,1 seconde, les impressions colorées perçues par les différents récepteurs de la rétine se superposent au niveau cérébral et conduisent à la perception d’une couleur blanche (souvent grise si les couleurs ne sont pas très saturées). Néanmoins, l’expérience historique est très démonstrative.
Comment l’homme peut-il s’approprier les couleurs de la nature ?
Soit en utilisant divers solvants pour extraire les colorants ; soit en broyant des solides colorés en poudre pour en faire des pigments.
Qu’est-ce que l’analyse spectrale et quelles sont ses applications ?
L’analyse spectrale consiste à examiner la réponse d’un échantillon de matière éclairé par un rayonnement, dans une certaine gamme de longueurs d’onde et à mesurer, en particulier, l’intensité absorbée par cet échantillon en fonction de la longueur d’onde qui l’éclaire. Cela permet de caractériser cet échantillon par sa signature spectrale : ainsi, les longueurs d’onde absorbées par l’eau et par l’alcool dans la région infrarouge du spectre ne sont pas les mêmes, et permettent donc de différencier ces deux corps.
Quelle est la différence entre un milieu acide et un milieu basique ?
Dans de l’eau utilisée comme solvant, on s’intéresse à la présence plus ou moins abondante de protons H+, c’est-à-dire de noyaux de l’atome d’hydrogène, qui sont les « particules acides ». Par convention, quand la concentration relative de ces H+ est supérieure à 1/10 000 000 (ou 10-7), la solution est dite acide et, à l’opposé, basique pour des concentrations inférieures.
Pourquoi les feuilles changent-elles de couleur à l’automne ?
Du fait de l’interruption de la production par la plante des pigments chlorophylliens, verts. On ne voit plus dès lors que les autres pigments, les carotènes et xantophylles, également présents dans les feuilles et dont les couleurs vont du jaune au rouge.
Alchimie/chimie : rupture historique ?
La chimie triomphe de l’alchimie à l’époque de Lavoisier, à la fin du XVIIIe siècle. Il faut se garder de jugements simplistes et péjoratifs sur l’alchimie. Au XVIIe siècle en particulier, à l’époque de la chimie naissante, coexiste avec celle-ci une alchimie elle aussi logique et rationnelle.
Qu’est-ce que la science chimique ?
La science chimique décrit et prédit les transformations de la matière sous l’influence d’agents, tels que le chauffage ou la présence d’autres substances. Elle procède en postulant l’existence d’objets microscopiques, les atomes, et des assemblées d’atomes que sont les molécules, les cristaux et les matériaux. Les changements dans la disposition relative des atomes au sein de ces collections d’atomes sont responsables des changements de la matière, ou réactions chimiques.
Exemple : oxydation de l’alcool en vinaigre. La formulation du premier est CH3CH2OH, celle du second, l’acide acétique, est CH3COOH : deux atomes d’hydrogène H sont soustraits à la molécule d’alcool tandis qu’un atome d’oxygène O lui est ajouté.
Chapitre de Pierre Laszlo, issu de Graines de Sciences 1, paru aux éditions Le Pommier en août 2004