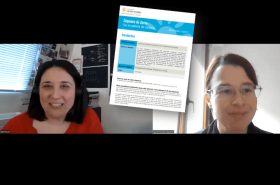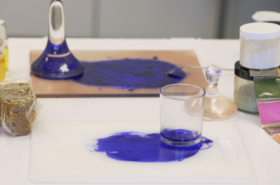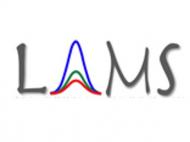Objectifs visés :
- Découvrir et s’approprier des protocoles expérimentaux qui permettent de transformer des solutions colorées (obtenues pendant la première étape du tutoriel “Peindre avec la nature”) en poudre de pigments ou en encres.
- S’approprier et mettre en œuvre une ou plusieurs séances pour la classe.
- Partager son expérience avec d’autres professeurs.
Déroulement du tutoriel :
- Suivre des protocoles expérimentaux.
- Consolider ses connaissances sur les pigments, colorants et laques.
- Découvrir le récit historique de l'invention de quelques couleurs.
- Consulter et choisir des ressources clés en main pour la classe.
- Enrichir un projet de classe sur l'écriture ou sur les cosmétiques.
- Réinvestir les notions apprises lors de ce tutoriel avec ses élèves, en classe, et échanger avec d'autres professeurs.