L'atmosphère dans laquelle nous vivons et que nous respirons est une source de phénomènes esthétiques spectaculaires.
Parmi ces manifestations, il en est une catégorie que tout le monde a vue : les mirages, si souvent observés sous forme de "flaques" au loin sur la route en été. Les lignes suivantes veulent apporter une explication des mirages, ainsi que quelques-unes de leurs propriétés les plus intéressantes.
Le principe des mirages
Un milieu optique est caractérisé par un indice, dit indice de réfraction qui "mesure" la vitesse de la lumière dans ce milieu. Plus cet indice est élevé, plus la lumière se propage lentement dans ce milieu. L'indice de réfraction de l'air dépend de sa densité et donc de sa température. Plus la densité ou la température est élevée et plus l'indice est faible.
La loi fondamentale de l'optique géométrique, le principe de propagation rectiligne de la lumière, n'est valable que dans un milieu homogène dans lequel l'indice de réfraction est le même partout. Plus généralement, le chemin emprunté par la lumière est celui pour lequel le temps de parcours est extrémum (minimum ou maximum) : c'est le principe de Fermat dont découlent les lois de Descartes sur la réflexion et la réfraction.
Lorsqu'on plonge un bâton dans l'eau, on observe que les rayons lumineux qui proviennent du bâton sont déviés lorsqu'ils passent de l'eau à l'air, car l'indice de l'air diffère de celui de l'eau : le bâton apparaît alors "brisé". Si l'indice de réfraction du milieu varie régulièrement d'un point à un autre, les rayons lumineux ne suivent plus une trajectoire rectiligne mais une courbe. Dans l'expérience ci-dessous, un laser émet un rayon lumineux qui traverse une cuve où l'indice diminue de bas en haut. On observe alors la déviation du rayon lumineux, vers les indices élevés.
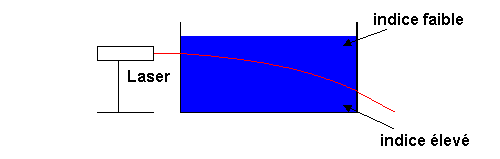
Les variations locales ou globales de température et de pression dans l'atmosphère engendrent de la même manière les phénomènes optiques si particuliers que sont les mirages.
Mirages inférieurs et supérieurs
Au niveau du sol, il peut exister localement des variations d'indice de faible étendue verticale, de quelques mètres à quelques dizaines de mètres. Ils ont pour origine soit une inversion de température en altitude, soit un réchauffement ou un refroidissement de l'air au niveau du sol. On voit donc que deux cas principaux peuvent se présenter.
Un sol ou une nappe d'eau chauds créent un gradient de température dirigé vers le bas, c'est-à-dire un gradient d'indice dirigé vers le haut. Dans un tel cas, les rayons provenant d'un objet s'incurvent vers le haut, et atteignent l'observateur en semblant provenir du sol ; on peut alors voir une image inversée de l'objet. On parle dans ce cas de mirages inférieurs. Ce sont ces mirages qui donnent l'impression d'observer des flaques d'eau sur une route chauffée par le soleil en été : on observe en fait les rayons provenant du ciel, dont notre œil a l'impression qu'ils viennent de la route.
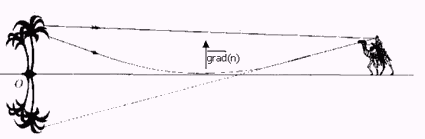
Voici un exemple de mirage inférieur :

Inversement, un sol froid (mer froide, banquise par exemple) crée un gradient d'indice dirige vers le bas : dans ce cas les rayons lumineux sont courbés vers le bas, et on parle alors de mirages supérieurs.

Voici ci-dessous un exemple de mirage supérieur sur un transporteur de minerais dans les Grands Lacs américains :

Apparitions
Dans les observations d'objets situés à grande distance, la courbure de la Terre et la courbure "naturelle" (due aux variations d'indice dans l'atmosphère) des rayons lumineux ont pour conséquence qu'au-delà d'une certaine distance, la base d'un objet distant, une montagne ou une île par exemple, voire tout l'objet, est masquée par la courbure de la Terre. Dans de telles observations, l'apparition d'un mirage supérieur est intéressante : accentuant la courbure des rayons lumineux, il permet la réapparition de la zone disparue de l'objet observé, voire de tout l'objet lui-même (il peut apparaître inversé).
Les mirages supérieurs se produisant plus facilement au-dessus d'une mer froide, cette situation a été plusieurs fois observée dans des ports, où des navires furent aperçus au loin plusieurs jours avant leur arrivée : cachés par l'horizon, ils n'auraient pas pu être vus en temps normal ! C'est aussi pour cela que depuis Nice on peut parfois voir la Corse alors que son point culminant, le Monte Cinto (altitude 2710m, distant de 225km), est normalement invisible.
On peut observer l'effet inverse en présence d'un mirage inférieur affectant la base de l'image d'un objet observé à grande distance qui peut disparaître sous l'horizon, alors que le reste n'est pas affecté par le mirage : on a alors l'impression de voir flotter l'objet au-dessus de l'horizon.
Ainsi lors des observations à grande distance, l'horizon semble éloigné en présence d'un mirage supérieur, et rapproché en présence d'un mirage inférieur.
Un type d'apparition très spectaculaire est l'effet Novaya Zemlya (nommé ainsi du nom de l'île de Nouvelle Zemble s'étendant dans l'océan arctique au nord de la chaîne de l'Oural en Russie où il fut observé par les naufragés d'un bateau d'exploration) : le Soleil apparaît après son coucher sous la ligne effective de l'horizon. Ceci est une conséquence d'un profil d'indice dans l'atmosphère très particulier : l'atmosphère agit comme un guide d'onde (voir schéma ci-dessous). Une partie de la lumière émise par le Soleil se propage selon une trajectoire particulière et peut atteindre le coté de la Terre plongé dans l'obscurité où elle est alors observée. L'effet de guide d'onde agissant sur les rayons incidents peu inclinés, l'effet Novaya Zemlya est surtout observable aux latitudes élevées.
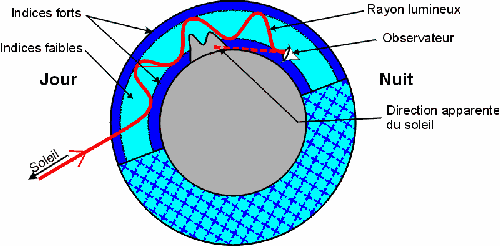
Déformations
Des profils d'indice très compliqués peuvent occasionner des déformations très importantes de certaines zones de l'objet observé : c'est ainsi que de nombreuses légendes de monstres marins ne sont en fait que des mirages.
Les Fata Morgana sont des combinaisons exceptionnelles de mirages supérieurs et inférieurs, où l'image d'un point est un segment vertical. Ces mirages confèrent à un horizon légèrement irrégulier l'apparence d'un paysage rempli de tours et de parapets et sont à la base de nombreuses légendes. En voici un exemple ci-dessous :

Lors du coucher du Soleil, l'épaisseur d'air traversée est maximale, les déviations des rayons lumineux sont maximales ; lors de la présence de mirages complexes, l'image du Soleil peut être très fortement modifiée. On peut alors observer un Soleil en bandes :

Un problème dans les observations astronomiques
Indépendamment des fluctuations dues aux variations de température, il existe une variation d'ensemble de la densité de l'air avec l'altitude, liée à la diminution de pression. En effet plus on s'élève en altitude, plus la pression et la densité de l'air diminuent. Le gradient d'indice qui en résulte est donc dirigé vers le bas, mais il est d'autant moins prononcé que l'altitude est plus élevée. Donc lorsqu'ils pénètrent dans l'atmosphère les rayons lumineux se courbent vers le sol et modifient la position apparente des astres, qui paraissent relevés sur l'horizon à l'observateur terrestre. C'est le phénomène de réfraction atmosphérique (qui est aussi la cause d'autres phénomènes d'optique atmosphérique comme le rayon vert par exemple). Il en résulte une erreur dans le relevé de la position angulaire d'un astre, et il est donc nécessaire d'apporter des corrections aux mesures astronomiques.
Le schéma suivant illustre ceci sur le cas le cas le plus commun du Soleil (les proportions n'étant pas respectées pour une plus grande clarté).
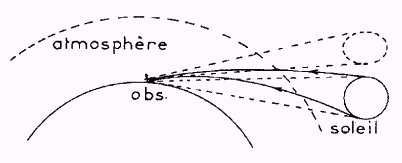
En outre, comme le gradient d'indice est d'autant moins prononcé que l'altitude est élevée, les rayons issus du bord inférieur du Soleil sont plus courbés que ceux issus du bord supérieur, ce qui diminue son diamètre vertical apparent. En revanche, la variation d'indice étant négligeable horizontalement, le diamètre horizontal apparent n'est pas modifié. Ainsi lors du coucher du Soleil, l'épaisseur d'atmosphère traversée étant alors maximale, le phénomène peut devenir visible à l'œil nu, et on observe un soleil aplati sur l'horizon.











